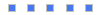

| Xavier Chanoine | 2.5 | Du caractère, mais encore trop jeune |
Le statut de Magic Boy du tandem Daikuhara Akira/Yabushita Taiji est un cas particulier dans l’Histoire de l’animation japonaise. Outre le fait qu’il soit coréalisé par le pionnier de l’animation en couleur au Japon, il est le premier film d’animation du pays à avoir été exporté aux Etats-Unis pour une exploitation en salles. Ce sera la MGM qui s’en occupera en juin 1961.
Le film en lui-même n’a rien révolutionné et ne se distingue pas par son originalité bien que son final devance de près de trente ans certains combats mystiques inhérents aux finals des wu xia les plus spectaculaires en provenance d’HK. Ces duels explosifs à coups de sorts faisant la joie des amateurs de pyrotechnie. En revanche, c’est pour son caractère et son exploitation toute particulière des codes du cinéma d’animation américain d’époque que ce Magic Boy vaut le détour. Ou comment comprendre en l’espace de 82 minutes les différences de ton et de sensibilité qui existaient entre les deux pays. Le Walt Disney puissant de l’époque contre l’apprenti nippon encore très loin d’avoir l’envergure des plus grands Ghibli. Pourtant le film du duo Daikuhara/Yabushita tente déjà de mêler avec une certaine maladresse animaux de la forêt, magie, sorcellerie et apprentissage de la vie. Mais là où les film de Disney jouent sur de véritables enjeux dramatiques (en 1959 sortait le très beau La Belle aux bois dormants, un bel exemple), Magic Boy revient aux fondamentaux éculés, comme le fait de démarrer de manière très classique en présentant des petits animaux de la forêt faire mumuse avec la nature. Les bases mettent un bon quart d’heure pour être placées alors, pendant ce temps, rien ne se joue : cinq minutes autour d’une table et un saladier de pommes de terre, cinq autres avec une attaque de guêpes. Pourtant, il est bien question d’un petit garçon aux pouvoirs magiques, non ?
Une volonté de ne pas attaquer tout de suite, de peur d’aller trop vite, trop loin. Comme si le public n’était pas encore tout à fait prêt à voir cette affreuse sorcière incarnée en salamandre –selon la légende- et qui reprend son apparence une fois sur terre, toujours accompagnée de chauve-souris. Et quel personnage, proprement effrayant sur toute la longueur, chacune de ses apparitions s’accompagne de gémissements de violons sortis tout droit de l’enfer. Elle semble flotter si l’on en croit les mouvements de ses longs cheveux, se déplace comme si elle était sous l’eau. Une image forte et récurrente contrastant drôlement avec le côté très classique de l’univers chevaleresque du film : des animaux capables de parler –mais juste un peu-, un beau samouraï et sa fine équipe de barbares, un petit garçon souhaitant coûte que coûte apprendre la magie pour vaincre les vilains. Et sa grande sœur, perchée sur une montagne, attendant son prince charmant. Disney n’est pas loin, sauf que ce dernier porte ici un masque de démon.
Effectivement, pour un film destiné aux petits et grands, un tel degré de violence et de sadisme serait proprement impensable à l’Ouest. Ou bien le moindre écart avec le politiquement correct serait placé en hors-champ, comme pour cacher cette violence qu’on ne saurait prendre de plein fouet parce que la petite Eleanor est venue voir une princesse, un prince et des fleurs imprimés sur pellicule. Côté Est, c’est la panacée. Sorcière démon à la diction proprement effroyable, katanas qui tranchent la chair, village incendié et pillé par les bandits, sorcière usant de son fouet pour défigurer une belle jeune femme ou mettre à l’amende un petit garçon en le projetant sur de la roche. Bien sûr, il n’y a aucun souci de réalisme dans cette affaire, le petit Sasuke, même dans la pire des situations, rebondit comme une boule de gomme partout où il tombe. On est clairement dans un univers mystique, emprunt de légende et de magie, où toutes les facilités pour se mouvoir sont de mise. Le mouvement, très fortement ancré dans la narration, est sans cesse dynamisé par la petite roublardise des animateurs et scénaristes, économisant moyens et temps pour faire bouger leur petit héros d’un point A vers un point B en le téléportant ou en le faisant voler. Pourquoi s’embêter à le faire se mouvoir sur un chemin tortueux, plein de courbes et de bidules géométriques ? C’est aussi l’une des faiblesses du film, c'est-à-dire ce sentiment étrange d’avoir à faire à un film misant tout sur ses ambitions mais qui n’arrive jamais là où il le souhaiterait, surtout face à un Empereur, qui cette fois-ci, est bien à l’Ouest du côté de la technique.
Pendant démoniaque d’un Disney, qui ne cesse de montrer ses sorcières qu’à travers des portraits bien connus en Occident (la vilaine verrue par-ci, la beauté dangereuse par-là), Magic Boy exploite la terreur à travers des figures cette fois-ci bien connues au Japon : lorsqu’elle est sous son jour le plus terrifiant, la sorcière semble porter un masque de démon, celui qu’on pouvait voir dans le film le plus « démoniaque » de Kaneto Shindo, Onibaba. Une manière de se mouvoir également, entre cauchemar et pures visions psychédéliques sorties des enfers de Nakagawa Nobuo. Le film semble être par moment vampirisé par le psychédélisme et la folie, notamment à travers une séquence de danse hallucinante, une manière remarquable de retranscrire l’épouvante à l’écran qu’on ne trouve pas chez les voisins américains. C’est aussi cette belle naïveté qui donne à Magic Boy des airs de film bancal, toujours sauvé lorsqu’il plonge dans l’horreur. Car à vrai dire, les séquences d’apprentissage de la magie –dont il est quand même ici grandement question- sont d’une effarante banalité, les personnages n’ont aucun charisme particulier (hormis cette petite peste qui embêtera deux bandits un peu idiots jusqu’au bout), l’animation n’est pas ce qu’il y a de plus travaillée. Mais il y a un début à tout, l’animation japonaise s’imposera à travers le monde et deviendra ce qu’elle est aujourd’hui : un énorme prisme d’idées visuelles et narratives en tout genre faisant le bonheur de plus d’un. On est d’accord.


