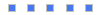
|
Par Florent (09/2002)
|
Là où Suzaku ressemblait à une copie d'élève appliquée de l'école de la distance et du plan-séquence, la rétrospective Kawase surprend en montrant que, si ses autres films ont certains choix esthétiques en commun avec ce dernier, Kawase Naomi a réalisé d'autres films beaucoup plus aventureux formellement et chargés émotionnellement (on me répondra avec le fameux cliché du " non-dit dans le cinéma japonais " mais que dire quand ni la réalisation ni les acteurs n'aident à faire ressentir ce non-dit comme peuvent le faire par exemple les regards de Hara Setsuko chez Naruse?). La rétrospective proposait une série de courts ou moyen métrages regroupés par programmes. Du fait des exigences financières des ayant droits, le second long métrage de fiction de Kawase Hotaru n'a pas été projeté. En partie à cause d'heures de séance peu pratiques (tous les jours à 17h ; tout le monde n'est pas en vacances en juillet), tout n'a pu être vu. Voici donc un compte-rendu des programmes auxquels nous avons pu assister.
Le Soleil Couchant (1996), qui se concentre sur la vie quotidienne de la propre mère de Kawase, permet de mieux cerner le projet de cinéma de Kawase : si les peu subtils gros plans sur les nuages évoquent les aspects les plus irritants de Suzaku, le film est beaucoup plus original que ce dernier au niveau mise en scène. Là où Kawase filmait ses souvenirs avec une distance (trop) classique dans le cinéma japonais, elle prend ici le parti de filmer sa grand-mère qui est aussi sa mère adoptive, un plat en train de cuire, une lettre, un petit bonhomme de neige de très près avec des caméras portées qui vitalisent agréablement le récit et qui évoquent l'impression de perte de repères ressentie lorsquon regarde fixement un objet. Du fait que le film est beaucoup plus dialogué, le spectateur peut partager la quête du souvenir de Kawase, les attentions qu'elle porte à sa mère. Mais tout ne fonctionne pas : les sons de tracteurs répétés ne sont pas créateurs d'émotions et le travail sonore ne fonctionne à plein que lors d'un cours plan sur des gouttes d'eau dont l'écoulement hypnotique évoque un des seuls maîtres revendiqués par Kawase, Andrei Tarkovsky. Si le film est très inégal, s'y affirment une démarche singulière et de vraies audaces formelles. Lors de la même séance, la Rétrospective proposait Dans le Silence du Monde, tourné six ans après, qui ancre magnifiquement Kawase parmi les grandes aventurières intérieures et formelles : il s'agit ici d'un journal intime de Kawase par caméra interposée. Au début du film, elle apprend la mort de son père et se tourne alors vers sa grand-mère pour essayer de retrouver ce parent absent. Ici les choix de photographie de Suzaku fonctionnent beaucoup mieux : le gros plan en caméra portée du début sur une tour suréclairée introduit bien le désarroi de la narratrice dans le plan suivant et l'idée de difficulté de recherche de soi et de ses repères se retrouvera au travers de multiples plans flous et des mouvements de caméra hésitants tout au long du film. Kawase nous gratifie également de plans d'une forte puissance évocatrice comme celui d'une actrice de kabuki au milieu d'un incendie ou d'un long travelling sur un arbre rappelant Le Sacrifice. La caméra s'accélèrera au moment où l'envie de découverte de soi devient urgente (les beaux plans de route en accéléré). Pour le reste, c'est à une mise à nu d'elle-même sans concessions que se livre Kawase. Dans sa quête, elle met en évidence un père beaucoup plus dur que ce qu'elle ne l'imaginait mais avec lequel elle souhaite malgré tout créer un lien. Et ce lien se matérialisera finalement par son désir de se faire tatouer comme son père l'était ce qui donnera une scène assez extraordinaire chez son tatoueur : au début, le tatoueur la met de nombreuses fois en garde car il dit ne pouvoir travailler en toute confiance avec une femme qui doute d'elle-même et risque peut-être de regretter son geste (il ajoute que " seuls les yakuzas se font tatouer " comme pour lui rappeler qu'elle est aussi un être sans repères) et pense qu'elle ne viendra pas à bout de ses tourments de cette façon. Suit une belle discussion sur la posture de l'artiste : le tatoueur se pose en artiste ne travaillant pas pour la récompense contrairement à Kawase qui a obtenu une récompense à Cannes ; suivent dès lors des plans-souvenirs de Cannes dans un ralenti stylisé digne de Wong Kar Wai communiquant au spectateur l'éloignement de tout ressenti par l'artiste à ce moment-là. Lors des gros plans très crus sur les souffrances de Kawase se faisant tatouer et ses blessures, le spectateur va partager la découverte de soi, le rétablissement des liens familiaux à l'œuvre (Kawase était orpheline). Le film peut alors s'achever de façon apaisée sur l'anniversaire de Kawase. Durant la fin du film, comme si elle était consciente qu'une autobiographie réussie contenait nécessairement sa part d'artificialité, Kawase va donner des signes soulignant le coté mis en scène de ce qui est vu : instructions du cadreur, claps retentissants. Dans le Silence du Monde est une expérience cinématographique belle et fascinante.
Une autre séance proposait le court Maintenant (1989): en 5 minutes, Kawase fixe les éléments (ruisseau, soleil levant, pleine lune…) avec sa caméra tremblante et offre une véritable symphonie de poche de la nature : les bruits sourds font basculer le spectateur dans un cinéma de sensations, un cinéma où la seule force de ce qui est cadré et entendu suffit à captiver le spectateur, un cinéma aussi simple qu'élaboré. Suivait un autre court, Papa's Ice Cream (1988), malheureusement non sous-titré même si l'émotion qu'il dégage transcende les langues : une adolescente entre dans un café glacier tenu par son père qu'elle voit pour la première fois. La caméra s'attarde sur un ruban, un cheveu, la bande son égrène des notes de piano cristallines ; derrière cette conversation proche du cinéma vérité, de beaux échanges de regard ont lieu. Le film a basculé dans un romantisme pur proche du versant apaisé d'un Iwai. Une glace dont le gout restera longtemps en bouche. Le Pays Boisé (1997), réalisé juste après Suzaku, n'est pas aussi captivant : dommage car l'idée de départ était assez belle, faire une sorte de reportage sur ce que c'est que vivre aujourd'hui dans le Japon paysan. Mais le film ne fonctionne que par à coups car les personnes interrogées répètent le plus souvent leur peur du vieillissement et la nostalgie de leurs jeunes années, ce qui finit par être lassant. Néanmoins, Kawase réussit à voler quelques beaux moments aux villageois : leur peur de voir leur visage vieillissant filmé en gros plan, le regret de s'être marié trop jeune, le couple dont la femme a du subir une opération, le chien effrayé par la ponceuse d'un villageois. Pour le reste, le style de réalisation est très proche de celui du Soleil Couchant mais le travail sur le son fonctionne plus souvent que dans ce dernier film : choc des chants traditionnels et des bruits métalliques traduit de façon purement cinématographique l'invasion progressive de la nature par l'homme (qui se retrouve aussi dans les plans de chemins de fer, échos à Suzaku), quand ils sont mêlés à des plans fixant un point lumineux de façon tremblante, les bruits sourds créent une impression de fin d'un monde, de disparition prochaine de ce Japon paysan (les personnages pensent ne pas pouvoir vivre longtemps à leur age) qui hante l'inconscient cinéphile depuis Kurosawa.
Le programme III proposait d'abord le court muet My J-W-F (1988). Ces trois fragments de scènes amoureuses qui se concluent respectivement par My F, My W, My J tirent leur force du désamorçage progressif par Kawase du romantisme des situations par des détails visuels tels que le sang ou une photographie suréclairée. White Moon (1993) beaucoup plus long poursuit dans cette voie sur un mode plus développé. Tout d'abord, Kawase va s'attacher à saisir les instants simples d'un jeune couple se découvrant amoureux avec une poésie énorme : elle va suivre un jeune homme à vélo en utilisant de longs plans contemplatifs dont il pourra entrer et sortir librement ; la légèreté des notes de piano accompagnant le film évoquent un Joe Hisaishi au mieux de sa forme ; Kawase enregistre leurs premiers contacts dans un restaurant puis à vélo, la gaucherie touchante dont ils font preuve, les bruits hypnotiques de cigales qui les accompagnent, leurs discussions et leurs rires. Mais elle va aussi réussir à instaurer un certain malaise avec une photographie faite d'orangés brûlants reflétant le soleil qui tape et qui se manifeste au moment où les amoureux sont les plus proches, même quand le plan remontre les amants devenus adultes, ayant fondé un foyer, le malaise est là. La caméra de Kawase s'attache fixement à certains points de l'horizon, fixe un soleil orange vif, la lune blanche du titre et nous transmet sa propre fascination pour les éléments. Le film comporte certes quelques longueurs : le jeune homme se regardant dans la glace en tenue de policier plusieurs fois, les longs plans sur son travail de gardien qui ne nous communiquent pas son attente. Mais dans l'ensemble ce moyen métrage est beau et touchant. Retour au très court avec A Small Largeness (1989) qui était non sous-titré. Heureusement, la Galerie du Jeu de Paume offrait cette fois-çi une feuille avec la traduction de l'intégralité des dialogues avant la séance. Un jeune garçon sort de la maison derrière son père. Suit alors le commentaire ironique de deux femmes qui envient une amie dont le mari va vivre loin pour le travail, bel exemple de vérité volée qui en dit long sur l'évolution des rapports de couple dans la société japonaise. Cet homme, c'est justement le père qui vient de partir et prend congé de son fils à la gare. Suit l'arrivée du garçon en classe en retard. Kawase saisit bien sa fausse indifférence, son ennui, ses regards vers une fille ou au travers de la fenêtre tandis que l'enseignante parle de l'islam et de Dante. Le film confirme ainsi la Kawase cinéaste-vérité et enregistreuse des jeunes années, de leur mélange de splendeur et de malaise (ce qui caractérise tous les courts du programme). Le film bifurque alors dans l'inconnu en montrant le garçon entrer deux fois dans la classe vide : est-ce un rêve ? le récit tout entier est-il un rêve ? La question reste en suspens tandis que le film s'achève en laissant le spectateur abasourdi. Comme si Kawase avait érigé l'imprévisible en règle.
Le programme XII proposait la toute dernière réalisation de Kawase, " Letter from a yellow cherry blossom " (2002). Il s'agit d'une commande d'un célèbre photographe et éditeur atteint d'un cancer, Nishii Kazuo, qui lui avait demandé de filmer les derniers instants de sa vie. Le cerisier jaune en fleur du titre, c'est l'arbre que Kawase va cadrer plusieurs fois fixement et longuement au cours du film pour montrer la simultanéité d'un élément naturel qui commence à vivre et d'un homme mourant. Elle voit dans la mort quelque chose faisant partie de l'ordre naturel des choses qui ne peut entre maîtrisé par la volonté de l'homme un peu à la manière du temps ou de la nature. Kawase et Nishii vont s'affronter sur leur conception du cinéma : quand Nishii lui demande pourquoi elle a filmé plutôt que photographié (elle a pourtant étudié ce dernier métier), Kawase répond qu'elle a eu en premier une caméra super 8 dans les mains. Nishii réussira alors à la déstabiliser en lui demandant ce qu'elle aurait fait si elle avait eu un appareil photo en premier : elle a du mal à répondre car filmer est désormais pour elle une nécessité ; elle filme parce qu'elle vit et pour laisser une trace de son passage sur terre. De l'autre coté, seule la vie obsède Nishii. Les deux s'opposent car Kawase défend la conception du cinéma enregistrement du réel tandis que pour Nishii le seul artiste qui vaille est celui pour qui le téléobjectif ouvre les portes vers une autre réalité. Kawase filme à grands coups de caméras portées qui enregistrent tous les détails de l'agonie, se déplacent dans la pièce pour montrer que Nishii a voulu transposer tout son mobilier dans sa chambre d'hôpital. Elle se place très près de Nishii pour rendre compte de son quotidien, ses bains de bouche, les glaires qu'il vomit, sa toux permanente, sa lutte vitale vaine. Elle crée des contrastes suscitant le malaise en variant les types d'image : argentique et brouillonne au début, numérique lorsqu'il s'agit de souvenirs de l'artiste au travail et enfin argentique en noir et blanc lors des derniers moments muets d'agonie. Si les objectifs sont différents, ce travail sur les différents types de grains et d'images la place parmi les cinéastes réfléchissant sur les types d'image et leur apport au récit cinématographique. Au final, ce qui était au départ un film commandé confirme Kawase comme cinéaste à suivre.
Cette rétrospective a permis de révéler une cinéaste à l'œuvre variée et audacieuse qui, si elle est inégale, recèle au moins un diamant, Dans le Silence du Monde, hyperréfléchi et prenant pourtant le spectateur aux tripes. Mais si le cinéma de Kawase est passionnant, il prend le risque que courent tous les cinéastes surdoués : celui d'être un cinéma trop théorique donc de donner une sensation d'artificialité. Son cinéma n'est justement jamais aussi inspiré que lorsqu'il insuffle un peu de danger dans son dispositif, quand un objet ou une question déstabilise la cinéaste et la laisse livrée à elle-même et à ses questionnements. Son cinéma est alors dans ses meilleurs moments d'une force émotionnelle énorme et l'on ressort heureux d'avoir pu partager un court instant les tumultes d'un être qui se cherche par le téléobjectif.